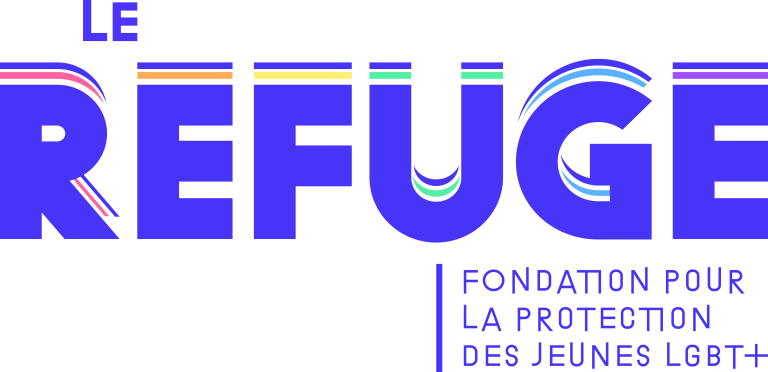Précarité sanitaire et psychologique des minorités sexuelles et de genre dans les Outre-mer.

7 février 2025
Par Loïc Chave
Les minorités sexuelles et de genre dans les territoires ultramarins français subissent une précarité sanitaire et psychologique exacerbée par des facteurs culturels, sociaux et économiques spécifiques. La situation dans les territoires d’Outre-mer est marquée par un rejet social plus prononcé, un accès aux soins limité, des discriminations institutionnelles et des formes de violences spécifiques.
69,4 % des hommes et 59 % des femmes vivant dans les Antilles et à la Guyane considèrent l’homosexualité comme « contre-nature » ou « un trouble psychologique » (ORS d’Île-de-France et INPES, 2014).
À la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, seulement 17,4 % des hommes et 23,2 % des femmes répondent que l’homosexualité est une sexualité comme les autres, tandis que 77 % des Français, au niveau national, estiment que l’homosexualité doit être tolérée (Pew Center Research, 2013).
Les études indiquent que l’homosexualité et la transidentité sont encore largement perçues de manière négative dans les Outre-mer. Ce rejet se traduit par une pression sociale extrêmement forte sur les personnes LGBTQ+, les poussant souvent à dissimuler leur orientation ou identité de genre sous peine de représailles familiales et communautaires.
Des violences intrafamiliales et sociétales accrues
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale confirme que « dans la grande majorité des régions ultramarines, l’homosexualité est perçue très négativement par la majorité des habitants ».
Le rapport relève de très nombreuses expulsions de foyers, violences sexuelles « correctrices », des mariages arrangés, des refus de plainte, des outings, des refus d’accès aux commissariats, et des outings médiatisés, visant à les « remettre dans le droit chemin » (Assemblée Nationale, 2018, Rapport d’information no 1090 sur la lutte contre les discriminations anti LGBT dans les Outre-mer).
Des témoignages à la Guadeloupe et à la Martinique révèlent un exil forcé des personnes transgenres vers d’autres territoires où elles peuvent espérer un minimum d’acceptation, notamment à Saint-Barthélemy.
Les rapports officiels indiquent des lacunes majeures dans la prise en charge des personnes LGBTQ+ victimes de discriminations. Des refus de dépôt de plainte sont régulièrement signalés, notamment par des policiers qui minimisent les agressions homophobes ou transphobes. Les associations LGBTQ+ dans les Outre-mer manquent de structures d’accompagnement. Le tissu médical local est peu formé aux besoins de santé spécifiques des personnes transgenres et homosexuelles.
Santé mentale : un impact direct du rejet et des discriminations
Les violences et la stigmatisation sociale subies par les personnes LGBTQ+ ont des conséquences directes sur leur santé mentale.
Les statistiques confirment cette dynamique, notamment celles de l’Agence des droits fondamentaux, à travers l’étude de 139 799 personnes LGBTI+ européennes, dont 13 525 personnes LGBTI françaises. Selon l’enquête, dans les deux dernières semaines, 91 % des 15-17 ans Français.e.s LGBTI+ se sont senties déprimées, et 89 % des 18-24, 79 % des 25-30 ans. En ce qui concerne les personnes trans, 98 % des 15-17 ans Français.es se sont senties déprimées, 97 % des 18-24 et 87 % des 25-39.
Cette précarité psychologique se chiffre également en taux de mortalité. Les jeunes LGBT sont confrontés à un risque suicidaire qui est sept fois plus élevé que celui de la population générale. Ce risque s’avère particulièrement marqué chez les garçons, où il est 5 à 10 fois supérieur. Il est, chez les filles, 2 à 4 fois plus élevé.
En France, 17 % des hommes gays ou bisexuels déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie, tandis que ce chiffre grimpe à 27 à 30 % chez les plus jeunes (moins de 21 ou 25 ans). En France, 34 % des jeunes transgenres ont tenté de se suicider. En comparaison, seulement 4 % des hommes exclusivement hétérosexuels rapportent avoir tenté de se suicider.
Cette précarité psychologique, résultat des violences subies par les personnes LGBTI+, conforte d’autres précarités : scolaire, professionnelle, économique, sanitaire, sociale…
Bien que les données spécifiques aux territoires d’Outre-mer soient limitées, le cumul du rejet social, des violences familiales et des discriminations institutionnelles laisse penser que ces chiffres sont encore plus élevés dans ces territoires.
Le manque de structures psychiatriques est une réalité préoccupante dans les Outre-mer. À la Guyane, une étude récente a révélé que 36,9 % de la population présente au moins un trouble psychiatrique ou psychique, un taux bien supérieur à celui de la France hexagonale. 24 % des personnes interrogées ont dit avoir traversé un épisode dépressif au cours des deux semaines ayant précédées l’étude.
Les jeunes LGBTQ+ sont particulièrement touchés par le manque de psychiatres et de psychologues formés aux questions de diversité de genre et d’orientation sexuelle. En l’absence de prise en charge adaptée, de nombreux jeunes sombrent dans l’isolement ou tentent de quitter leur territoire pour chercher un accompagnement en hexagone.
Santé sexuelle : une situation alarmante à la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique
Les défis en matière de santé sexuelle sont particulièrement préoccupants dans les Outre-mer, notamment à la Guyane et dans les Antilles. L’entrée dans la sexualité y est plus précoce qu’en hexagone, avec une moyenne de 15,6 ans pour le premier rapport sexuel à la Guyane, contre 17,5 ans en France hexagonale.
Cette précocité, couplée à un manque d’éducation sexuelle adaptée, favorise la transmission des infections sexuellement transmissibles (IST). La Guyane enregistre le taux d’incidence du VIH le plus élevé de France, avec 0,9 cas pour 1 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne nationale.
Le dépistage reste encore un sujet tabou, en raison des discriminations et du manque d’accès aux soins adaptés. Par ailleurs, la prévalence de la syphilis et de la gonorrhée est en forte augmentation, soulignant l’urgence de campagnes de prévention ciblées pour les minorités sexuelles et de genre.
Le rapport de l’Assemblée nationale de 2018 déplore l’absence de données précises sur les discriminations et les besoins sanitaires des personnes LGBTQ+ dans les Outre-mer, freinant ainsi la mise en place de politiques publiques adaptées.
L'impératif d’action pour les minorités LGBTQ+ dans les Outre-mer
La précarité sanitaire et psychologique des minorités sexuelles et de genre dans les Outre-mer est systémique et renforcée par des facteurs culturels, économiques et institutionnels spécifiques.
L’absence de reconnaissance officielle et le manque de statistiques précises entravent une prise de décision éclairée et adaptée. Il est donc essentiel de mener des études spécifiques sur la santé mentale et sexuelle des personnes LGBTQ+ dans ces territoires. L’Observatoire des vulnérabilités queers recommande que ces recherches couvrent l’ensemble des pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Concernant la France, ces territoires incluent la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, ainsi que Saint-Barthélemy. Pour le Danemark, il s’agit du Groenland, tandis que pour les Pays-Bas, cela concerne Aruba ainsi que les Antilles néerlandaises : Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Sint-Maarten.
Par ailleurs, il est impératif de renforcer les dispositifs de sensibilisation dans les établissements scolaires et de santé ; développer des structures de soins spécialisées, notamment en santé mentale et sexuelle ; former les professionnels de santé et les forces de l’ordre aux discriminations LGBTQ+.
Face à ces urgences, des initiatives voient le jour. En 2024, Le Refuge a implanté un accueil de jour à Cayenne pour soutenir les jeunes LGBTQ+ en difficulté. Ce lieu, inédit sur le territoire, permet au jeune de trouver un accompagnement social, administratif, juridique, psychologique et sanitaire renforcé, notamment grâce au réseau de professionnels sensibilisé par le Refuge.
Benoit Cascade, directeur du développement de la Fondation Le Refuge, souhaite « davantage mobiliser l’expertise de la Fondation pour mettre en lumière les réalités difficiles vécues par les jeunes LGBT+ ultramarins, afin de défendre la mise en place de dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les communautés de ces territoires ».

Pour suivre les actualités du Refuge
Nous soutenir
Parce qu’ils sont LGBT+, des milliers de jeunes de toutes origines et milieux sociaux vivent chaque année le drame du rejet familial.
C’est pour sauver ces vies abîmées que Le Refuge existe.